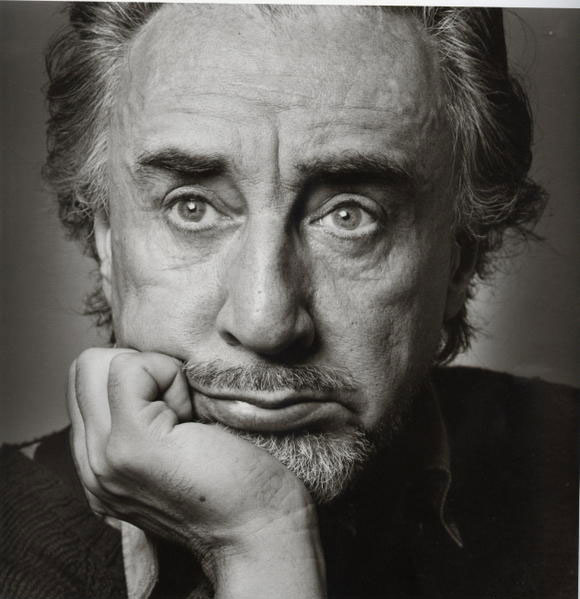
©
2012 Léon Herschtritt /
LA COLLECTION
"Droits de reproduction interdits" veuillez contacter
www.lacollection.eu
pour toutes demandes d'utilisation"
La
promesse de l'aube
J'étais un enfant lorsque ma mère m'apprit l'existence
d'une cohorte ennemie et je pressentis qu'un jour, pour elle,
j'allais la défier.
Il
y avait Totoche, le dieu de la bêtise, Merzavka, le
dieu des vérités absolues, Filoche, le dieu
de la petitesse, des préjugés, du mépris,
de la haine. Il y avait d'autres dieux, plus mystérieux
et plus louches, plus insidieux et masqués, difficiles
à identifier.
Nous sommes aujourd'hui de vieux ennemis et c'est de ma lutte
avec eux que je veux faire ici le récit ; ma mère
avait été un de leurs jouets favoris ; dès
mon plus jeune âge je m'étais promis de la dérober
à cette servitude.
Ce fut à treize ans que j'eus pour la première
fois le pressentiment de ma vocation.
J'étais alors élève de quatrième
au lycée de Nice et ma mère avait, à
l'hôtel Negresco, une de ces " vitrines "
de couloir où elle exposait les articles que les magasins
de luxe lui concédaient.
Depuis treize ans, déjà, seule, sans mari, sans
amant, elle luttait ainsi courageusement, afin de gagner,
chaque mois, ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer
le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le
bifteck de midi - ce bifteck qu'elle plaçait chaque
jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme
le signe même de sa victoire sur l'adversité.
Ma mère debout, me regardait manger avec cet air apaisé
des chiennes qui allaitent leurs petits.
A ce moment-là, elle avait déjà cinquante
et un ans. Un âge difficile, lorsqu'on a seulement un
enfant pour tout soutien dans la vie.
Ses propres ambitions artistiques ne s'étaient jamais
accomplies et elle comptait sur moi pour les réaliser.
J'étais, pour ma part, décidé à
faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle
devînt, par mon truchement, une artiste célèbre
et acclamée et, après avoir longtemps hésité
entre la peinture, la scène, le chant et la danse,
je devais un jour opter pour la littérature, qui me
paraissait le dernier refuge, sur cette terre, de tous ceux
qui ne savent pas où se fourrer.
Ma mère possédait un grand talent de reconstitution
historique, par la voix et le geste, et semblait bien prouver
qu'elle avait été, dans sa jeunesse, la grande
artiste dramatique qu'elle prétendait avoir été.
Je ne suis cependant jamais parvenu à élucider
ce dernier point entièrement.
Je savais qu'elle était fille d'un horloger juif de
la steppe russe ; qu'elle avait été très
belle, qu'elle avait quitté sa famille à l'âge
de seize ans ; qu'elle avait été mariée,
divorcée, remariée, divorcée encore -
et tout le reste, pour moi, était une joue contre la
mienne, une voix mélodieuse, qui murmurait, parlait,
chantait, riait - un rire insouciant, d'une gaieté
étonnante, que je guette, j'attends, que je cherche
en vain, depuis, autour de moi ; un parfum de muguet, une
chevelure sombre qui coule à flot sur mon visage et,
murmure à l'oreille, des histoires étranges
d'un pays qui, un jour, allait être le mien.
La France que ma mère évoquait dans ses descriptions
lyriques et inspirées depuis ma tendre enfance avait
fini par devenir pour moi un mythe fabuleux, entièrement
à l'abri de la réalité, une sorte de
chef-d'œuvre poétique, qu'aucune expérience
humaine ne pouvait atteindre ni révéler.
Elevé dans ce musée imaginaire de toutes les
noblesses et de toutes les vertus, je passai d'abord mon temps
à regarder autour de moi avec stupeur, et ensuite,
l'âge d'homme venu, à livrer à la réalité
un combat homérique et désespéré,
pour redresser le monde et le faire coïncider avec le
rêve naïf qui habitait celle que j'aimais si tendrement.
Oui, ma mère avait du talent - et je ne m'en suis jamais
remis.
Quant à moi je n'attachais nulle importance à
ce que je pouvais être ou ne pas être d'une manière
provisoire et transitoire, puisque je me savais promis à
des sommets vertigineux, d'où j'allais faire pleuvoir
sur ma mère mes lauriers, en guise de réparation.
Car j'ai toujours su que je n'avais pas d'autre mission ;
que je n'existais, en quelque sorte, que par procuration ;
que la force mystérieuse mais juste qui préside
au destin des hommes m'avait jeté dans le plateau de
la balance pour rétablir l'équilibre d'une vie
de sacrifices et d'abnégation. Je croyais à
une logique secrète et souriante, dissimulée
aux recoins les plus ténébreux de la vie. Je
croyais à l'honorabilité du monde. Je ne pouvais
voir le visage désemparé de ma mère sans
sentir grandir dans ma poitrine une extraordinaire confiance
dans mon destin.
Aux heures les plus dures de la guerre, j'ai toujours fait
face au danger avec un sentiment d'invincibilité. Rien
ne pouvait m'arriver, puisque j'étais son happy end.
Dans ce système de poids et mesures que l'homme cherche
désespérément à imposer à
l'univers, je me suis toujours vu comme sa victoire.
J'avais huit ans, je crois, lorsque la vision grandiose qu'elle
avait de mon avenir m'apparut.
Nous étions alors installés provisoirement à
Wilno, en Pologne, en attendant d'aller nous fixer en France.
Ma mère gagnait notre vie en façonnant des chapeaux
pour dames, dans notre appartement transformé en "
grand salon de modes de Paris ".
Nous étions alors dans une situation matérielle
déplorable, il faisait terriblement froid à
Wilno, où la neige montait lentement du sol, le long
des murs sales et gris.
Ma mère revenait de ses périples à travers
la ville enneigée, posait ses cartons à chapeaux
dans un coin, s'asseyait, allumait une cigarette et me regardait
avec un sourire radieux.
J'allais l'embrasser. Ses joues sentaient le froid. Elle me
tenait contre elle, fixant par-dessus mon épaule, quelque
chose de lointain, avec un air émerveillé. Puis
elle disait :
- Tu seras ambassadeur de France.
Je n'avais que huit ans, mais ma décision était
déjà prise : tout ce que ma mère voulait,
j'allais le lui donner.
Puis nos affaires prirent meilleure tournure. Le spectacle
de ma mère faisant des projets, était pour moi
quelque chose de fabuleux et de bouleversant.
J'eus une gouvernante française et je fus vêtu
d'élégants costumes de velours spécialement
coupés pour moi et, pour faire face aux intempéries,
je fus affublé d'une surprenante pelisse d'écureuil
dont les centaines de petites queues grises, tournées
vers l'extérieur, provoquaient l'hilarité des
passants.
Mon père avait quitté ma mère peu après
ma naissance. Je savais que l'homme qui m'avait donné
son nom avait une femme, des enfants, qu'il voyageait beaucoup,
allait en Amérique, et je l'ai rencontré plusieurs
fois. Il n'est vraiment entré dans ma vie qu'après
sa mort.
Je savais bien qu'il était mort pendant la guerre dans
une chambre à gaz, exécuté comme Juif,
avec sa femme et ses deux enfants, alors âgés
de quinze et seize ans.
En 1956 j'appris par une lettre un détail particulièrement
révoltant sur sa fin tragique : il était mort
de peur, sur le chemin du supplice, à quelque pas de
l'entrée.
L'homme qui est mort ainsi était pour moi un étranger,
mais ce jour-là il devint mon père, à
tout jamais.
Lorsque la petite entreprise de ma mère fut déclarée
en faillite, nos meubles furent saisis. Ma mère avait
cependant eu la précaution de mettre à l'abri
son trésor précieux, une collection complète
de vieille argenterie impériale, qu'elle avait emportée
avec elle de Russie.
Avec les quelques centaines de zlotys que nous avions pu sauver
du désastre, sous décidâmes de nous rendre
à Varsovie, où ma mère y avait des parent
et des amis, mais surtout il y avait un lycée français.
A Varsovie nous vécûmes difficilement dans des
chambres meublées.
Ma mère fit mille choses pour nous maintenir à
flot. Elle fut courtière de bijoux, acheta et revendit
des fourrures et des antiquités. Elle fit aussi de
la gérance d'immeubles, fut placeuse en publicité
et se chargea de mille autres besognes dont je ne me souviens
plus aujourd'hui ; mais chaque matin à dix heures,
lors de la récréation, elle était là
avec son thermos de chocolat et de tartines beurrées.
De mon côté, je me surpassais dans mes efforts
pour voler à son secours. J'écrivais des poèmes
et je les lui récitais à haute voix. Elle les
écoutait toujours attentivement. Peu à peu son
regard s'éclairait, les traces de fatigue disparaissaient
de son visage et elle s'exclamait, avec une conviction absolue
:
- Lord Byron ! Pouchkine ! Victor Hugo !
J'ai gardé de mon premier contact avec la France, le
souvenir d'un porteur à la gare de Nice, avec sa longue
blouse bleu, sa casquette, ses lanières de cuir et
un teint prospère, fait de soleil, d'air marin et de
bon vin.
Nous nous installâmes dans une maison de famille, rue
de la Buffa. A Nice je me mis à écrire pour
de bon. Attaqué par le réel sur tous les fronts,
refoulé de toutes parts, me heurtant partout à
mes limites, j'ai pris l'habitude de me réfugier dans
un monde imaginaire et à y vivre, à travers
les personnages que j'inventais, une vie pleine de sens, de
justice et de compassion. Instinctivement, sans influence
littéraire apparente, je découvris l'humour,
cette façon habile de désamorcer le réel
au moment même où il va vous tomber dessus.
Plus je regardais le visage vieilli, fatigué, de ma
mère, et plus mon sens de l'injustice et ma volonté
de redresser le monde et de le rendre honorable grandissait
en moi. J'écrivais tard dans la nuit.
Ma mère avait cinquante-deux ans lorsqu'elle fit sa
meilleure affaire, la vente d'un immeuble de sept étages
dans l'ancien boulevard Carlonne, aujourd'hui boulevard Grosso.
L'acheteur, frappé par l'esprit d'entreprise et l'énergie
de ma mère, lui en confia la gérance.
Ce fut ainsi que l'Hôtel-Pension Mermonts ouvrit ses
portes à la grande clientèle internationale.
Je crois qu'elle a vécu là quelques-uns de ses
meilleurs moments.
Un jour j'appris ce qu'elle me cachait depuis deux ans : ma
mère était diabétique et, chaque jour
elle se faisait une piqûre, avant de commencer sa journée.
Une peur abjecte me saisit. Je sentis qu'il fallait me dépêcher,
qu'il me fallait en toute hâte écrire le chef-d'œuvre
immortel, lequel, en faisant de moi le plus jeune Tolstoi
de tous les temps, me permettrait d'apporter immédiatement
à ma mère la récompense de ses peines
et le couronnement de sa vie.
Plus tard, en 1933, je quittai Nice et m'inscrivis à
la Faculté de Droit d'Aix-en-Provence. Ma mère
m'envoyait des billets lapidaires, remplis d'exhortations
à la vaillance et à la ténacité.
" Courage mon fils tu reviendras à la maison le
front ceint de lauriers… "
La légende de mon avenir était ce qui la tenait
en vie.
C'est ainsi que jai vécu, jusqu'à vingt-deux
ans, du travail d'une vieille femme malade et surmenée.
L'automne approchait et mon départ pour Paris devenait
imminent. A Paris, je m'enfermai dans ma minuscule chambre
d'hôtel et, négligeant les cours à la
Faculté de Droit, je me mis à écrire
de tout mon saoul.
En 1938 je fus incorporé à Salon-de-Provence.
J'étais heureux, j'aimais les avions. Je ne fus même
pas nommé sergent, pas même caporal-chef : je
fus nommé caporal.
Je lui racontai que j'avais séduit la femme du Commandant
de l'Ecole.
- Raconte-moi tout, m'ordonna-t-elle.
Elle aimait les jolies histoires, ma mère. Je lui en
ai raconté beaucoup.
L'idée que la France pouvait perdre la guerre ne m'était
jamais venue.
Après de multiples pérégrinations, j'avais
décidé de passer en Angleterre, à bord
d'un Den-55. Il n'était pas question de me dérober
: j'étais tenu. Je sentais le regard d'admiration et
de fierté de ma mère posé sur moi. J'avais
à défendre un conte de nourrice dans l'esprit
d'une vieille dame.
L'aérodrome de Bordeaux-Mérignac, le 15 juin
1940. Je m'apprêtais à monter dans un avion lorsqu'un
cycliste vint me prévenir qu'on me demandait d'urgence
au téléphone. C'était ma mère
qui dans le chaos de la défaite, avait réussi
à me joindre. L'avion sur lequel j'étais sur
le point de monter décolla, se cabra, explosa et s'écrasa
au sol. Il n'y eut pas de survivants. Au téléphone,
ce fut une série de cris, de mots, de sanglots, cela
ne relevait pas du langage articulé.
Après Londres j'embarquai pour l'Afrique. C'est ainsi
que la première nouvelle de mon roman Education Européenne
fut écrit à bord du navire qui nous emportait
vers les combats du ciel africain.
Les lettres de ma mère, sans date, hors du temps, devaient
me suivre partout fidèlement. Pendant trois ans et
demi, j'ai été soutenu ainsi par un souffle
et une volonté plus grands que la mienne et ce cordon
ombilical communiquait à mon sang la vaillance d'un
cœur trempé mieux que celui qui m'animait.
Mais je tiens à le dire clairement : je n'ai rien fait.
Je me suis débattu. Je ne me suis pas vraiment battu.
Un jour cependant, nous eûmes une sortie un peu plus
mouvementée que d'habitude. La Croix de la Libération
devait être épinglée sur ma poitrine quelques
mois plus tard, sous l'Arc de Triomphe, par le Général
de Gaulle lui-même.
Puis un événement insolite se produisit dans
ma vie, je reçus du Ministère des Affaires étrangères
une lettre officielle me suggérant de poser ma candidature
au poste de secrétaire d'ambassade.
Le destin de ma mère prenait tournure.
Le ruban vert et noir de la Libération bien en évidence
sur ma poitrine, au- dessus de la Légion d'honneur,
de la Croix de Guerre, les galons de capitaine sur les épaules,
la casquette sur l'œil, mon roman en français
et en anglais dans la musette bourrée de coupure de
presse et, dans ma poche, la lettre qui m'ouvrait les rangs
de la Carrière, avec juste ce qu'il fallait de plomb
dans le corps pour faire le poids, ivre d'espoir, de jeunesse,
de certitude et de Méditerranée, je revenais
à la maison après avoir démontré
l'honorabilité du monde, après avoir donné
une forme et un sens au destin d'un être aimé.
Mais à l'hôtel-Pension Mermonts où je
fis arrêter la jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir.
Il me fallut plusieurs heures pour connaître la vérité.
Ma mère était morte trois ans et demi auparavant,
quelques mois après mon départ pour l'Angleterre.
Au cours des derniers jours qui avaient précédé
sa mort, elle avait écrit près de deux cent
cinquante lettres, qu'elle avait fait parvenir à son
amie en Suisse. Je continuai donc à recevoir de ma
mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer
alors qu'elle était morte depuis plus de trois ans.
Le cordon ombilical avait continué à fonctionner.
Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une
promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé de
manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après
cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et
vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances.
On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère
comme un chien abandonné. [..] Vous êtes passés
à la source très tôt et vous avez tout
bu. Lorsque la soif vous reprend vous avez beau vous jeter
de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y
a que des mirages. […]. Je ne dis pas qu'il faille empêcher
les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il
vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un à
aimer.
Commentaires
Autobiographie
?
Il serait peut-être plus sage de parler d'autofiction.
Mais autofiction est trop vague ; roman n'est pas exact, reste
plutôt autobiographie fictive ou fiction autobiographique,
impossible de définir ce livre singulier.
Gary écrivit " Chacun de nous se fait une illusion
du monde […] ; les grands artistes sont ceux qui imposent
à l'humanité leur illusion du monde. Gary s'est
toujours flatté d'être comme ses saltimbanques,
un illusionniste ".
" Tout est permis dans l'art, sauf l'échec…
Lorsque l'art n'échoue pas, son mensonge est honnête,
lorsqu'il échoue, aucune " vérité
" ne saurait l'empêcher d'être un mensonge
piteux ".
Ou encore " Ne dis pas forcément les choses comme
elles se sont passées, mais transforme les en légendes,
et trouve le ton de voix qu'il faut pour les raconter ".
La promesse de l'aube " fut créée en 1958.
Gary était alors diplomate, consul général
à Los Angeles.
Sa mère l'a mis au monde puis elle l'a façonné
selon son désir, comme un Dieu sa créature.
Il est son œuvre unique et son chef-d'œuvre. Mais
lui, de son côté, l'a aimée, portée,
protégée, détestée aussi pour
son pouvoir sur lui, son intransigeance et même pour
ses sacrifices dont il lui sera impossible d'être quitte,
jamais.
Si bien qu'il n'a trouvé qu'une solution pour lui rendre
hommage et la mettre à distance : la créer à
son tour, lui rendre vie dans une œuvre dont cette fois
il sera l'auteur.
(Mireille Sacotte) écrit :
Avec " La promesse de l'aube " elle naît de
sa plume, sublime, toute-puissante, tragique, mais aussi fragile,
naïve autant que rusée, comique, voir grotesque,
insupportable, envahissante, non plus une personne mais un
personnage magnifique. Et il l'impose entre toutes les femmes.
Lorsqu'il raconte ses exploits il invite à désacraliser
le héros, et il fait grand usage de l'humour, ce qui
donne un ton particulier au livre.
Les scènes sont la plupart du temps comiques pour le
lecteur, et tragiques, pour le protagoniste enfant.
Le sujet du livre est aussi celui d'une intégration
à un nouveau pays, plus ou moins de rêve, qu'est
la France, qui tantôt accueille, tantôt refuse
d'accueillir, comme tous les pays. Le troisième personnage,
en dehors de la mère et du fils, est la France.
Il se plaisait à dire : " Je n'ai pas une goutte
de sang français, mais le sang français coule
dans mes veines "
" Mon livre est avant tout une œuvre littéraire,
rien n'est tout à fait vrai, mais rien n'est tout à
fait faux. Mon livre est une œuvre d'art, ce n'est pas
un document ".
Biographie
Romain Gary est né à Wilno le 21 mai 1914, dans
la grande métropole spirituelle et intellectuelle que
les Juifs ashkénazes avaient surnommée la "
Jérusalem de Lituanie ", centre d'études
juives le plus important d'Europe orientale.
Sa mère Mina Owczynska avait divorcé à
Varsovie d'un premier époux lorsqu'elle épousa
Arieh-Leïb Kacew. Arieh, négociant en fourrures,
appartenait à la catégorie sociale des "
petits bourgeois " de l'Empire russe.
Mina avait déjà 35 ans lorsque son fils Roman
naquit. Cette année-là éclata la première
guerre mondiale.
Tous les Juifs de Lituanie orientale et de Courlande furent
dispersés dans toute la Russie.
Roman et sa mère éprouvaient une grande fascination
pour l'univers du cinéma, et en particulier pour Ivan
Mosjoukine, le célèbre acteur russe du cinéma
muet. Gary laissa se développer la légende selon
laquelle, il aurait été conçu par la
star russe et sa mère en voyage à Paris.
Les difficultés matérielles commencèrent
après la séparation de Mina et Leïb. Prélude
au départ chez les parents de Mina à Swaniacy,
et quelques mois plus tard à Varsovie.
Les années que Romain Gary vécut à Wilno
et à Varsovie furent douloureuses. Etre juif en Pologne
était considéré comme une maladie honteuse.
Romain Gary en a tant souffert qu'il a répugné
à raconter la véritable histoire de son enfance.
Si Gary en voulait tant à son père, c'est pace-que
ce dernier l'a abandonné en 1925 pour vivre avec Frida
Bojarski, une femme qui avait dix-sept ans de moins que Mina.
Frida lui donna deux enfants, Wala, dite Valentina et Pavel.
Gary et sa mère ont fait partie de la troisième
vague d'environ 10 000 personnes qui émigrèrent
en France entre 1908 et 1939.
C'est à Nice que Roman Kacew vivra son adolescence
et sa jeunesse.
C'est en se présentant à l'Hermitage, l'un des
plus somptueux établissements de Nice, construit sur
la colline de Cimiez, que Mina se lia avec la famille Agid.
Le directeur était Alexandre, le père des trois
futurs amis intimes de Romain : Roger, René et Suzanne.
Alexandre Agid accorda à Mina la permission de proposer
sa brocante dans ses hôtels, allant même jusqu'à
mettre à sa disposition des vitrines pour l'exposer.
Les affaires connaissent des hauts et des bas. Mina, prématurément
vieillie et atteinte d'un diabète grave, se tue à
la tâche.
Une certaine sécurité s'installa enfin lorsqu'un
Ukrainien l'engagea comme gérante de la modeste pension
Mermont située 7, bd Carlone (aujourd'hui François
Grosso).
Après des études à la faculté
de droit d'Aix-en-Provence et à la faculté de
droit de Paris, Gary apprend le métier d'aviateur.
Plus tard il rejoint la France Libre et est incorporé
dans les forces aériennes françaises libres.
En 1944 il publie à Londres son premier roman qui deviendra
en français " l'Éducation européenne
". La même année il épouse Lesley
Blanch. Petite, menue, blonde, elle évoque une poupée
en biscuit, anglaise précisément, fragile et
précieuse. Elle a trente-sept ans (soit sept années
de plus que lui) et une carrière de journaliste d'excellente
renommée. Rédactrice à Vogue, elle s'occupe
en particulier du cinéma et du théâtre,
milieu où elle est connue, appréciée,
parfois redoutée. Entre eux, l'humour sera, avec la
complicité littéraire, le meilleur ciment.
Nommé Secrétaire d'ambassade à Sofia
(Bulgarie), puis premier secrétaire d'ambassade à
Berne (Suisse), Chargé d'Affaires à La Paz (Bolivie),
Consul Général de France à Los Angeles,
Gary poursuit une carrière fulgurante.
En 1956, alors qu'il se trouve en Bolivie, il apprend qu'on
lui a décerné le prix Goncourt pour " Les
racines du ciel ". Rentré à Paris, la diplomatie,
la politique, la littérature, le Tout-Paris honorent
Romain Gary. Gary soigne sa publicité, cultive sa différence,
sa moustache à la Clark Gable, son allure hautaine
et sa voix charmeuse. Il joue les stars, posant pour Paris
Match au zoo du bois de Vincennes, où il offre des
quignons de pains à ses amis éléphants,
ou s'affichant dans les rues de Paris avec un bonne de coton
bolivien, orange et vert, qu'il a acheté au marché
de La Paz.
Sa légende s'étoffe. Théâtral,
cabotin, résolument mystificateur, Gary sait d'expérience
que le succès passe par la comédie. A sa parution,
" Les racines du ciel" divise la critique, et pose
la question du style : Gary est-il ou n'est-il pas "
un bon écrivain " ?
Les avis sont partagés. Gary connaît ses faiblesses
mais ne laisse pas toujours à son éditeur le
temps de " peigner " ses livres. Dès qu'il
l'a achevé, il faut que son roman paraisse, de toute
urgence, même un peu en désordre, et dans sa
brutalité. Une deuxième édition des Racines,
après le Goncourt, éliminera les plus grosses
erreurs.
En 1957 à Los Angeles il participe à la vie
hollywoodienne. C'est là qu'il rencontre Jean Seberg.
Elle a vingt et un an. Lui, quarante-cinq. Elle est blonde,
pâle et claire, près de ce Consul de France qui
ressemble à un mexicain. Elle est célèbre.
Encore plus que lui. Elle a donné son visage à
la " Jeanne d'Arc " d'Otto Preminger. Elle a joué
Cécile, dans " Bonjour tristesse ", d'après
Sagan, et elle vient d'achever le tournage d' "A bout
de souffle " au côté de Jean-Paul Belmondo,
sous la direction de Godard.
Sa coiffure taillée à la serpe, à ras,
elle n'en paraît que plus féminine, plus fragile,
sous ses quelques mèches très douces, qui accentuent
en elle la pureté des traits, la perfection du contour.
D'une beauté qui se moque des fards, cette très
jeune femme attire Romain au premier coup d'oeil. Elle correspond
si bien à l'idéal féminin de ses romans,
qu'il a l'impression de tomber amoureux de l'une de ses créations,
et de voir son rêve prendre corps. Entre un mariage
de raison et des amours de quelques nuits, il rencontre enfin
une femme issue de son propre rêve, tombée de
son propre ciel.
Entre Gary et Seberg, il y a ce soir-là quelques images
de légende : une héroïne de Preminger face
à un Consul de France, une star rive gauche adorée
par Godard, par Truffaut, face à un écrivain
Goncourt, une Américaine du Middle-West parisianisée
face à un Français un peu trop russe, un peu
trop gaulliste, un peu trop Juif.
Il y a toute la magie d'une première rencontre et d'un
coup de foudre amoureux.
Au printemps ils s'installent 108, rue du Bac dans un vaste
appartement de huit pièces.
Lorsque Lesley apprendra que Jean est enceinte elle accordera
à Gary le divorce, après 17 ans de vie commune.
En 1961, Gary délaisse sa carrière diplomatique,
il choisit l'amour et la voie du scandale, désespérant
Lesley qui le supplie de garder la face. Il va préférer
Jean et une nouvelle bohème. Sa rencontre avec elle
coïncide avec un changement profond de sa personnalité,
à une nouvelle étape de sa vie.
Elle est luthérienne, marquée dans l'enfance
par les principes d'une religion qui est l'une des plus austères
du monde et qui, même transportée en Amérique,
continue d'exalter toutes les valeurs du puritanisme. Tendre,
d'une sensibilité exceptionnelle, que la vie n'a pas
polie, Jean éprouve d'instinct pour tout ce qui souffre
une pitié que rien ni personne ne sait apaiser.
Devant l'injustice et la souffrance, bouleversée au
plus profond de l'être, elle part en croisade. Elle
recueille les chiens, les chats, ouvre sa maison aux hippies,
aux clochards, aux vagabonds. En 1968 elle s'engage corps
et âme dans la lutte antiraciste.
Gary reconnaît l'innocence, la pureté de Jean,
mais taxe sévèrement d'idéalisme naïf,
son engagement qui la dépasse. Il refuse de partager
la culpabilité des Blancs face aux Noirs. Il préfère
se tenir à l'écart d'une guerre qui ne le concerne
pas.
Le portrait qu'en trace Gary est plein d'indulgence, de désespoir
contenu. " Il est difficile d'aimer une femme que l'on
ne peut ni aider, ni changer, ni quitter.Je n'en peux plus
dit-il. Dix-sept millions de Noirs américains à
la maison, c'est trop, même pour un écrivain
professionnel…… habitué à capitaliser
la souffrance des autres dans des best-sellers. J'ai déjà
fait de la littérature avec la guerre, avec l'occupation,
avec ma mère, avec la liberté de l'Afrique,
avec la bombe, je refuse absolument de faire de la littérature
avec les Noirs américains ".
Il a l'intime conviction que la plupart de ce que nous appelons
des problèmes idéologiques sont essentiellement
psychiatriques. Il ne pressent que trop combien le militantisme
blanc, particulièrement celui des protestants américains,
s'enracine dans l'angoisse d'un inexorable sentiment de culpabilité,
et tend en fait à l'autodestruction.
Jean brûle d'une flamme qui vise à monter au
bûcher.
En septembre 1968 ils se séparent, puis divorcent,
tout en demeurant unis, vivant dans le même appartement
coupé en deux. Diego, leur fils, vit avec son père.
Elle les rejoint pour Noël.
En 1970, Jean, qui est toujours officiellement Mme Gary, se
retrouve enceinte. Romain décide d'assumer la paternité
de l'enfant. Ils se réconcilient. Un article du Newsweek
affirme que le bébé n'est pas de Gary mais d'un
activiste noir. Le 23 août Jean est transportée
à l'hôpital de Genève et accouche prématurément
d'une petite fille, Nina, qui meurt deux jours plus tard.
En 1974 Gary a la soixantaine. Il a toujours belle allure.
Une vie bien remplie. C'est le moment qu'il choisit pour ruiner
- à ses propres yeux - sa respectabilité en
publiant sous un pseudonyme, et cela à l'insu même
de son éditeur, Gros-Câlin puis la Vie devant
soi. Gary vient d'entrer dans la plus fantastique épreuve
qu'il ait jamais connue de sa vie d'aventures.
L'aventure Ajar est absolument sans précédent
dans l'histoire de la littérature, même conçue
à l'échelon de la planète. Aventure folle
et tragique dans laquelle, aux antipodes du canular, les années
Ajar marquent à la fois l'apothéose du génie
fabulateur de Gary et la cassure essentielle dans laquelle
il faut chercher un des mobiles de son suicide.
Dans sa vie, dans son oeuvre, dans son apparence physique
même, Gary n'a cessé de changer, de superposer
les visages, les noms, les identités, finissant par
écrire sa vie comme l'une des pièces de son
oeuvre.
" L'habitude de n'être que soi-même finit
par nous priver totalement du reste du monde, de tous les
autres ; je, c'est la fin des possibilités… ".
Il dit aussi "J'éprouve parfois le besoin de changer
d'identité, de me séparer un peu de moi-même,
l'espace d'un livre".
Avec Ajar, Gary se donne un masque avec un faux nom, jeu littéraire
qui est en l'occurrence moins un camouflage qu'une réincarnation.
Car il y a dans cette signature d'Ajar aussi neuve que l'était
Gary aux premiers temps d'Éducation européenne,
la tentation d'un nouveau départ, comme une nouvelle
jeunesse, d'un recommencement.
L'oeuvre lui ressemble. On y retrouve, sans trop de difficulté,
sa vision à la fois pessimiste et ironique du monde,
son idéalisme et son cynisme.
Ajar sera du côté de la farce, mais de la farce
triste, à la manière des Âmes mortes
de Gogol.
L'oeuvre pourtant innove dans le style, quelque part entre
Vian et Queneau : jeux de mots, entorses à la syntaxe,
à la grammaire et au vocabulaire, mutilations et gags
du langage.
Gary est devenu un gêneur. D'abord par son allure honorable
(Croix de la Libération, Légion d'honneur, gaulliste,
Consul de France, prix Goncourt), puis par ses gros tirages
depuis trente ans ; on n'attend plus rien de neuf d'un mandarin
des Lettres, même s'il s'habille tantôt comme
un loubard, tantôt comme un clochard.
Gary se met à chercher un pseudonyme pour incarner
l'anarchiste qu'il est lui-même et que sont seuls à
connaître ses vrais lecteurs. Triste à cause
de la critique qui boude ses oeuvres en ne leur accordant
plus qu'un coup d'oeil blasé et las, comme si chacun
de ses nouveaux livres était un pensum, il décide
alors de tenter le diable et de masquer sa plume. Il s'appellera
Ajar pour voir. Voir si, en trompant son monde, il rencontrera
un accueil ou plus désastreux ou plus enthousiaste,
mais au moins un véritable accueil, au lieu de la marée
tiède des habituels commentaires.
Ce pseudonyme qui le réincarne dans une nouvelle peau
lui redonne en même temps une virginité, la toute
fraîcheur d'un débutant.
Mais il lui faut aussi exhiber sa marionnette et la manipuler
sur la scène d'une comédie fantastique. Émile
Ajar ce sera quelqu'un de la famille : un petit cousin, Paul
Pavlowitch, dont la véritable identité restera
tout d'abord secrète.
Celui-ci aime profondément Romain Gary. Il a lu tous
ses livres, retenu toutes ses histoires et tous ses personnages,
c'est un amateur de littérature. Le rôle d'Ajar
lui sied, c'est une deuxième peau. Au point que lui-même
un jour ne saura plus s'y reconnaître.
Gary s'amuse. La marionnette qu'il a choisie pour interpréter
Ajar, révèle un talent authentique de comédien,
il mime admirablement un écrivain génial, il
a le sens de la phrase et de la repartie, il sait cultiver
son propre mystère.
Avec le prix Goncourt le canular Ajar s'officialise. Aucun
écrivain ne pouvant en principe recevoir deux fois
ce même prix, Gary fait écrire à Paul
une lettre pour le refuser.
Mais Hervé Bazin, président de l'Académie
lui répondra "L'Académie vote pour un livre,
non pour un candidat. Le prix Goncourt ne peut ni s'accepter
ni se refuser, pas plus que la naissance ou la mort. M. Ajar
reste couronné".
Ce prix aurait pu donner à Gary l'occasion de révéler
sa paternité de l'oeuvre. Or il continue le jeu. Il
laisse galoper son ombre, peut-être par refus d'un scandale
qu'il n'a pas envie d'affronter, plus sûrement par esprit
de curiosité, esprit diabolique, qui veut chercher
à voir jusqu'où on peut aller trop loin….
La supercherie s'enracine dans le jeu du mensonge, ou plutôt
des faux-semblants. Désormais aux yeux de la presse
et de l'édition, Romain Gary se double d'un "neveu"
plus génial, plus brillant que lui-même.
Ajar c'est l'art, moderne et révolté, gueulant,
casseur. Tandis que Gary glisse du côté des vieilles
barbes…. La vie devant soi est un triomphe.
Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus
valable, paru la même année est lu dans l'ensemble
avec ce même dédain, cette même pitié
moqueuse qu'on accorde dans les salons aux don Juan en déclin.
Il semble conter la tristesse d'un vieil homme impuissant,
tandis que la Vie devant soi apparaît avec éclat
comme le chef-d'oeuvre d'un écrivain effervescent,
maître de ses dons, ou comme dit Gary, maître
de sa Puissance.
Lorsque Gary publie Clair de femme, l'année
suivante, des mauvaises langues disent qu'il cherche à
plagier Émile Ajar, à copier son neveu, et se
plaisent à y relever des "ajarismes" flagrants,
preuve tout à la fois de son épuisement, et
de la supériorité du neveu sur l'oncle finissant.
L'étoile d'Ajar brille plus fort que celle de Gary.
Tandis qu'il fait parader Paul sur la scène publique,
lui s'enferme avec la volonté de revivre par procuration
et de créer une histoire à leur mesure pour
dérouter les derniers poursuivants. Leurs identités
vont se perdre, s'embrouiller, glisser de l'une à l'autre.
Période intense d'écriture et de gestion d'oeuvre,
les années Ajar marquent pour Gary une puissante activité
créatrice, qui paraît sous une double signature
mais est en fait le produit d'un seul écrivain. C'est
une période passionnée et sombre, dont le vrai
déroulement se joue en coulisses, avec des masques,
et qui ne laisse voir sur scène qu'une partie de son
théâtre secret.
Le 8 septembre 1979 : découverte du corps de Jean coincé
sous une couverture contre le siège arrière
de sa voiture. Elle avait disparu depuis dix jours. A côté
un tube de barbituriques. L'autopsie révélera
un taux extrêmement élevé d'alcoolémie.
Elle avait quarante et un an.
Le 10, en présence de son fils Diego, Gary tient une
conférence de presse chez Gallimard. Il domine mal
son émotion. Preuves à l'appui il accuse le
F.B.I. d'avoir délibérément cherché,
par ses calomnies, à détruire Jean, en 1970,
et de l'avoir rendue folle. Il évoque la mort de ce
bébé dont elle avait tenu qu'il fût enterré
dans un cercueil de verre afin de bien prouver qu'il était
blanc. C'est depuis cet événement qu'elle est
allée de clinique psychiatrique en clinique psychiatrique,
de tentative de suicide, en tentative de suicide.
Son vingt-neuvième livre, L'Angoisse du roi Salomon,
tout inspiré par l'âge et par la solitude, et
bercé d'un reste d'espoir, marque sa longue marche.
Gary est vieux, Gary est seul. En dépit de son fils,
en dépit de Leïla.
Leïla Chellabi est une jeune femme de quarante ans, longue
et légère comme une danseuse, brune, avec des
cheveux bouclés, coupés courts, et un profil
de princesse crétoise. De père d'origine turque
et de mère bordelaise, elle vit près de lui
depuis déjà un an.
C'est une femme calme, silencieuse, que Romain compare à
un chat, indépendante, pourtant tout à fait
capable de passions. Elle est divorcée, elle a un fils.
Rue du Bac, elle apporte un nouvel ordre féminin, organisant
les repas, offrant toujours une présence paisible et
rassurante dans un climat d'inquiétude propre à
Romain Gary, que les anciennes terreurs de Jean et tout le
cirque d'Ajar n'ont fait qu'alourdir ces dernières
années.
Mais secrètement, rue du bac, la farce aura vite tourné
au cauchemar. Pavlowitch n'est plus le jouet, la marionnette
sage ; tout se passe comme si le " chargé de comédie
" voulait jouer au maître chanteur, par exemple
en réclamant une augmentation des tarifs de sa commission.
Les rapports entre oncle et neveu s'en aigrissent.
A la fin du printemps le fisc se manifeste et ajoutera encore
d'angoisse aux tourments quotidiens de Romain Gary, qui en
vient même à se sentir pris au piège de
ses propres manoeuvres, tant il se retrouve traqué
à la fois par la vieillesse, par Ajar, et même
par le succès.
Dans son livre Europa, il écrit " Je ne
crois pas qu'il y ait une éthique digne de l'homme
qui soit autre chose qu'une esthétique assumée
dans la vie jusqu'au sacrifice de la vie elle-même".
Précisément comme son personnage, Gary va choisir
sa mort. Elle sera son dernier numéro d'artiste.
Le mardi 2 décembre 1980, en fin d'après-midi,
après avoir cessé d'écrire depuis plusieurs
mois et être devenu l'ombre de lui-même, Romain
Gary introduisit dans sa bouche le canon d'un revolver et
appuya sur la détente.
Cinq semaines avant sa mort il avait confié au Matin
: " Je ne suis pas méconnu. Je suis inconnu ".
Et cependant Gary ne s'est pas tué sous un coup de
cafard. Son suicide semble avoir été longuement
prémédité. Comme un suicide de raison
et de lucidité folle quand on a fait le tour de tout
et qu'on n'en peut plus d'exister. Son message destiné
à la presse semblait marquer d'un point final toutes
ces interrogations, sans vraiment les éclairer.
C'est peut-être Clair de femme qu'il faudrait
interroger. " Il y a dans ce roman la dérision
et le nihilisme qui guettent notre foi humaine et nos certitudes
sous le regard amusé de la mort, écrivait Gary.
Les dieux païens nous guettent installés sur l'Olympe
de nos tripes. Notre vie n'est peut-être que le divertissement
de quelqu'un". [...] Tout se passe comme si la vie était
un music-hall, un cirque où un suprême senôr
Galba, pitoyable pitre alcoolique, dresseur et montreur de
chiens s'amuserait à nos dépens ".
Dans Pseudo il écrit " Cette nuit-là, j'ai
eu de nouvelles hallucinations ; je voyais la réalité,
qui est le plus puissant des hallucinogènes. C'était
intolérable. J'ai un copain à la clinique qui
a de la veine, qui voit des serpents, des rats, des larves,
des trucs sympa, quand il hallucine. Moi je vois la réalité
".
Six
mois après son suicide, dans un ultime opuscule posthume,
Gary " tuait " Émile Ajar et renaissait de ses cendres.
" Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. ".
Bibliographie :
Romain Gary/Émile Ajar " de Jean-Marie CATONNE' - Éditions"
Les dossiers Belfond "
"Romain Gary " de Dominique BONA - Éditions Mercure
de France.
"Romain Gary, le caméléon" de Myriam
Anissimov, Éditons Denoël
"La
promesse de l'aube de Romain Gary" de Mireille Sacotte
- Edition folio - Foliothèque
Ce
site
a pour vocation de promouvoir la lecture. C'est pourquoi les
résumés de livre, les biographies sont faites
à partir d'extraits des ouvrages même que j'ai
consultés et proposés à la lecture. Afin
de mieux préserver le style de l'auteur et le mettre
en évidence, je n'ai entrepris aucune réécriture.
Internet fonctionnant un peu comme une immense bibliothèque
mondiale, les ouvrages que j'ai trouvés dignes de lecture
y sont donc proposés. J'espère que les auteurs
n'y verront aucun inconvénient car ma véritable
intention est de mieux les faire connaître du grand public.
R.D.
Citations
Au
delà de cette limite votre ticket n'est plus valable
"Je
n'ai jamais été un homme de plaisir mais un
homme de sanctuaire. Lorsque je te serre très fort
dans mes bras, ton corps me donne aide et protection. La vie
attend pour me reprendre dans ses tourments quand je cesse
d'être intouchable. Il y a autour de nous une chrétienté
enfin accomplie de tendresse, de pardon et de justice rendue,
et ensuite, lorsque nos souffles se séparent et qu'il
faut recommencer à vivre coupés en deux, il
reste la connaissance heureuse du sanctuaire et une oeuvre
immatérielle faite de certitude de retour."
"Ecoute,
la vie ne va pas se fâcher parce que tu es heureuse.
On peut dire tout ce qu'on veut de la vie mais une chose est
certaine : elle s'en fout. Elle n'a jamais su distinguer le
bonheur du malheur. Elle ne regarde pas à ses pieds
"
"Elle
émergeait des draps et des oreillers comme d'une bataille
de cygnes et tendait la main à la recherche d'une branche
pour regagner le rivage. Au moment de la plainte, elle cachait
son visage comme si elle avait honte et empêchait son
cri de monter au ciel en se mordant la main. Je lui dis que
j'étais peiné par ce manque de charité
envers les cieux."
"Mais
dans les bras de Laura, il n'y avait pas d'illusion possible.
Jamais je n'avais aimé avec un don si total de moi-même.
Je ne me souvenais même plus de mes autres amours, peut-être
parce que le bonheur est toujours un crime passionnel : il
supprime tous les précédents. Chaque fois que
nous étions unis, ensemble, dans le silence des grandes
profondeurs qui laissent les mots à leurs travaux de
surface et que, très loin, là haut, les milles
hameçons du quotidien flottent en vain avec leurs appâts
de menus plaisirs, de devoirs et responsabilités, il
se produisait une naissance du monde bien connue de tous ceux
qui savent encore cette vérité que le plaisir
réussit parfois si bien à nous faire oublier
: vivre est une prière que seul l'amour d'une femme
peut exaucer".
"Le
regard neuf de l'enfant sauve même les trottoirs de
l'usure".
"Il
paraît qu'il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est
seulement un bon moment à passer".
"Il
ne s'agit pas d'un plaidoyer, dans ces pages. Ce n'est pas
non plus un appel au secours et je ne me mettrai pas ce manuscrit
dans une bouteille pour le jeter à la mer. Depuis que
le monde rêve, il y a déjà eu tant d'appels
au secours, tant de bouteilles jetées à la mer,
qu'il est étonnant de voir encore la mer, on ne devrait
plus voir que les bouteilles."
Les
racines du ciel
"Quand
vous n'en pouvez plus, faites comme moi: pensez à des
troupeaux d'éléphants en liberté en train
de courir vers l'Afrique, des centaines et des centaines de
bêtes magnifiques auxquelles rien ne résiste,
pas même un mur,pas même un barbelé, qui
foncent à travers les espaces ouverts et qui cassent
tout sur leur passage, qui renversent tout et tant qu'ils
sont vivants, rien ne peut les arrêter- la liberté
quoi!"
"Vers
dix heures du soir, il traversèrent Sionville, roulèrent
le long du fleuve, entre les manguiers (…). La nuit avait
une présence, un corps, une vie bruissante ; on sentait
ses sueurs, son intimité ; dans l'épaisseur
du jardin, le chœur des insectes était une pulsation
intense qui donnait à l'obscurité des flancs
palpitants, une respiration précipitée (…)."
"..
Dans la nuit du désert, la forme blanche avait bougé
dans le sable et Morel s’était arrêté
un instant devant l’adolescent assoupi. Le visage était
grave et presque triste, sous la lumière bleue. Puis
les lèvres tremblèrent, prononcèrent
quelques mots et Morel demeura longuement immobile, penché
sur cette tête rebelle hantée jusque dans ses
rêves par la seule certitude dont l’homme pût
se réclamer. "
"Plus
une œuvre est imaginative, plus elle est convaincante
et plus je reçois des lettres de lecteurs me demandant
si " c'est vrai, c'est vraiment vrai ? "
" Heureusement, pour m'aider un peu à oublier,
il y avait le cinéma. Nous passions au cinéma
toutes nos soirées. […] Nous en sortions énivrés,
avec des voix un peu roques, cherchant à prolonger
quelques secondes encore, par nos attitudes, nos gestes, par
notre langage, la vie étonnante à laquelle nous
avions été mêlés. La beauté
des femmes, la force des hommes, la violence de l'action,
tout cela donnait à la réalité, qui nous
reprenait à la sortie des salles, un caractère
d'insupportable banalité. Cette réalité
nous paraissait un décor, une mauvaise toile peinte
qu'il suffit de crever courageusement pour trouver, derrière,
la vraie vie, celle des films".
L'avenue
Dante, qui mène de l'hôtel-pension Mermont au
marché de la Buffa, s'ouvrait devant ma fenêtre.
De ma table de travail je voyais ma mère venir de loin.
[…] Chaque fois que je reviens à Nice, je me rends
au marché de la Buffa. J'erre longuement parmi les
poireaux, les asperges, les meons, les pièces de bœuf,
les fruits, les fleurs et les poissons. Les bruits, les voix,
les gestes, les odeurs et les parfums n'ont pas changé,
et il ne me manque que peu de chose, presque rien, pour que
l'illusion soit complète. Je reste là pendant
des heures et les carottes, les chicorées et les endives
font ce qu'elles peuvent pour moi".
"
Ma mère rentrait toujours à la maison les bras
chargés de fleurs et de fruits. Elle croyait profondément
à l'effet bienfaisant des fruits sur l'organisme et
veillait à ce que j'en mangeasse au moins un kilo par
jour. Je souffre de colite chronique depuis. Elle descendait
ensuite aux cuisines, arrêtait le menu, recevait les
fournisseurs, surveillait le service du petit déjeuner
aux étages, écoutait les clients, faisait préparer
les pique-niques des excursionnistes, inspectait la cave,
veillait à tous les détails de l'affaire".
"Voyez-vous,
j'ai de la vie une idée commedia dell'arte. Nous mimons
notre vie et puis, brusquement, conscients de la pantomime,
nous interrompons le jeu en pleine action pour échanger
nos impressions, devant le public des étoiles. Mais
ce sentiment dell'arte poussé à l'extrême,
comme dans mon cas, tue le spectacle. Il ne reste plus alors
que des clowns constamment en dehors de toute action, de toute
histoire perceptible, de tout sujet, des " à part
" incompréhensibles".
"Je ne crée pas, je ne compose pas ; j'improvise.
Dans le théâtre d'aujourd'hui, donc, il n'y a
plus de place pour moi".
"J'écris entièrement par vanité….
j'ai besoin d'être admiré. C'est ma grande faiblesse,
mais aussi ma seule force, parce que si je n'avais pas le
goût de l'exploit, je n'aurais rien fait de ce que j'ai
fait dans ma vie et j'aurais été, à l'heure
actuelle, hôtelier sur la Côte d'Azur, dans l'affaire
de ma mère".
"Je ne me suis pas senti le même depuis. Au cours
d'un voyage à Varsovie, j'ai visité le musée
de l'Insurrection. Je savais tout sur le meurtre des six millions
de Juifs, j'avais lu tous les livres, j'avais vu les documents.
Mais si je parlais souvent de mes origines juives, au fond
je ne me sentais pas juif, malgré mon attachement à
la mémoire de ma mère. Or, devant la section
du musée consacrée à la révolte
du Ghetto, je me suis soudain écroulé et je
suis resté évanoui vingt minutes. Je ne m'étais
peut-être pas rendu compte du poids qu'avait eu pour
moi, dans cette ville où j'ai été élevé,
cette immense, cette massive absence : celle des Juifs".
"Je
plonge mes racines littéraires dans mon " métissage,
je suis un bâtard et je tire ma substance nourricière
de mon " bâtardisme " dans l'espoir de parvenir
ainsi à quelque chose de nouveau, d'original. Ce n'est
d'ailleurs pas un effort : cela m'est naturel, c'est naturel,
c'est ma nature de bâtard, qui est pour moi une véritable
bénédiction sur le plan culturel et littéraire.
C'est pourquoi d'ailleurs certains critiques traditionnalistes
voient dans mon œuvre quelque chose d' "étranger
".
"Elsa
Triolet écrivait : j'ai fait de mon mieux pour m'intégrer,
mais pour les Français je reste une étrangère
[…] L'amour que l'immigré peut avoir pour son
pays d'adoption est toujours un amour malheureux […]
Pour s'aimer il faut être deux, or l'indigène
ne rend pas son amour à l'étranger".
"La plus grande puissance spirituelle de tous les temps,
c'est la Connerie"
"Chère Méditerranée ! Que ta sagesse
latine, si douce à la vie, me fut donc clémente
et amicale, et avec quelle indulgence ton vieux regard amusé
s'est posé sur mon front d'adolescent ! Je reviens
toujours à ton bord, avec les barques qui ramènent
le couchant dans leurs filets. J'ai été heureux
sur ces galets"
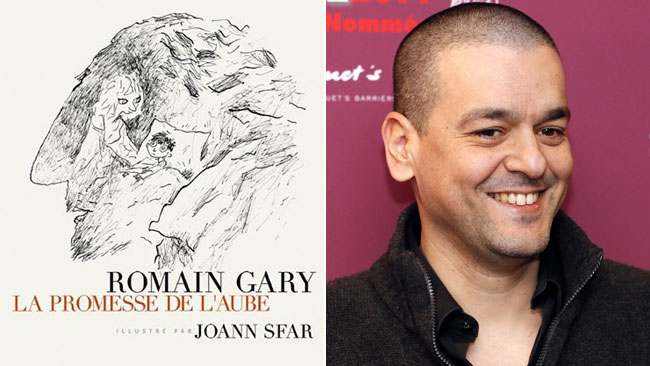
Editions Gallimard
|